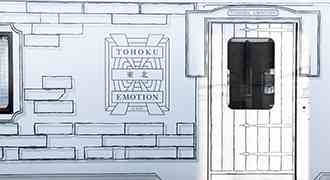Café Society – Film d’ouverture du Festival de Cannes


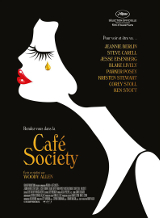 Hollywood. Les années 30. Phil Dorfman, agent de stars de cinéma, reçoit un appel du Bronx. Sa sœur veut lui envoyer son plus jeune fils, Bobby, afin qu’il l’aide à trouver du travail dans l’industrie du cinéma. Bobby est enthousiaste. Son oncle un peu moins. Il l’engage finalement comme coursier et lui présente Vonnie, l’une de ses secrétaires. Elle est chargée par Phil de faire découvrir la ville à son neveu. Qui tombe sous son charme. Malheureusement, la belle n’est pas libre…
Hollywood. Les années 30. Phil Dorfman, agent de stars de cinéma, reçoit un appel du Bronx. Sa sœur veut lui envoyer son plus jeune fils, Bobby, afin qu’il l’aide à trouver du travail dans l’industrie du cinéma. Bobby est enthousiaste. Son oncle un peu moins. Il l’engage finalement comme coursier et lui présente Vonnie, l’une de ses secrétaires. Elle est chargée par Phil de faire découvrir la ville à son neveu. Qui tombe sous son charme. Malheureusement, la belle n’est pas libre…

Quatre-vingt ans. Mais toujours sur les plateaux, derrière la caméra. Et tous les ans, les salles s’obscurcissent afin de projeter son dernier film. Le rendez-vous est devenu une habitude. Une habitude pour ceux qui attendent avec impatience de voir si ce Woody Allen sera le chef-d’oeuvre qu’ils attendent depuis quelques années (pour ma part depuis Match Point).
Dès le générique, le spectateur se retrouve en terrain connu, avec la musique jazzy qui débute et le casting qui défile. Puis une voix off. Celle du réalisateur qui, s’il n’apparaît plus à l’écran depuis maintenant quelques films, devient le conteur de cette romance à trois protagonistes. Assez convenue, celle-ci se révèle être la faiblesse du film, alors qu’elle est censée en être le point central. Ayant l’habitude des coups de théâtre dont le cinéaste a le secret, il était possible d’en attendre un peu plus de sa part ici.
Mais finalement, le triangle amoureux sert uniquement de prétexte. Un prétexte pour aborder le vrai sujet du film : l’Amérique des années 30. Et là, Woody Allen livre toute l’ampleur de son talent de metteur en scène, scénariste et directeur d’acteurs.

Si le conte romantique manque un peu de souffle allenien, le reste est tout simplement jouissif. Woody Allen n’a en rien perdu de son génie de dialoguiste, offrant des scènes de vaudeville jubilatoires où il jongle avec les mots autant qu’avec les situations. Les disputes des parents de Bobby autour de la religion juive, les magouilles de son gangster de frère aîné ou encore les citations pseudo-philosophiques de son beau-frère communiste sont autant de moments qui apportent du sel à l’ensemble.
Du génie, Woody Allen en a également dans le choix de sa distribution, faisant appel à des acteurs plutôt rares au cinéma – comme Corey Stoll (Midnight in Paris, House of Cards) dans le rôle du grand frère gangster, ou Blake Lively (The Town, Gossip Girl) qui joue la sublime épouse de Bobby. Privilégiant toujours la spontanéité des comédiens, sa direction d’acteurs fait souvent des miracles. Exit le visage de dépressive auquel Kristen Stewart (Vonnie) nous a jusque-là habitué, et place à une actrice lumineuse à la voix envoûtante. De même, Steve Carell (l’oncle Phil) a laissé de côté son jeu exubérant, privilégiant la retenue. Enfin, Jesse Eisenberg (Bobby), d’abord débordant de maladresses puis prenant peu à peu de l’assurance, offre une belle évolution à son personnage, au fur et à mesure qu’évolue le film.

Au delà de ses qualités indéniables, Café Society est aussi et surtout un film d’ambiance où l’on plonge avec délice dans le Hollywood puis le New-York des années 30. Rues ensoleillées de Beverly Hills. Plages de Californie. Projections de films avec Ginger Rogers ou Gary Cooper. Effervescence des soirées mondaines puis des night-clubs où l’on joue du jazz jusqu’au bout de la nuit. Tout est là pour entraîner le spectateur dans cette atmosphère rétro si particulière. Et tellement élégante.

- La direction d'acteurs
- Des dialogues toujours aussi irrésistibles
Réalisation : Woody Allen
Scénario : Woody Allen
Casting : Jesse Eisenberg , Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Parker Posey, Corey Stoll, …
Durée : 1h 36min
Genre : Woody Allen
Sortie en France : 11/05/2016
Distribution : Amazon Studios (États-Unis) et Mars Films (France)
Production : Letty Aronson, Stephen Tenenbaum et Edward Walson