Destins d’hommes, la fuite comme renouveau ?
Quatre destins d’hommes, quatre vies livrées à nos regards de lecteurs avec cette envie de nous toucher, de nous questionner, de nous faire partager l’intimité d’instants fragiles. Les doutes s’installent, ils sont partie prenante de la vie qu’ils teintent d’émotions pures. Avec Nos cheveux blanchiront avec nos yeux, Thomas Vinau présente le parcours d’un homme trop tôt confronter à ses responsabilités. La fuite sera pour lui non pas un but solitaire et égoïste mais un moyen de basculer dans la paternité et de l’assumer avec plus d’assurance. Walter, le personnage central du roman de Sophie Schulze devra fuir son pays l’Allemagne. Loin de chez lui il se construira une nouvelle identité que les expériences multiples vont sculpter délicatement. Jean lui aussi fuit quelque chose. Au volent de sa voiture il arpentera le Sud de la France avec l’objectif de rallier Marseille. Le nouveau personnage de Christian Oster devra cependant composer avec ces chemins de traverses qui l’amènent à rencontrer des destins tout aussi bouleversés que le sien. Et que dire du Turquetto, grand peintre de la Renaissance italienne, adulé puis banni pour ses origines ? Au travers de ces parcours s’affichent à la vue de tous les difficultés à appréhender un monde dont la lecture échappe à nombre d’entre nous. Et si la fuite était finalement le meilleur moyen de renaître, de basculer durablement dans un monde qui, faute de nous convaincre, peu toutefois nous surprendre encore ?
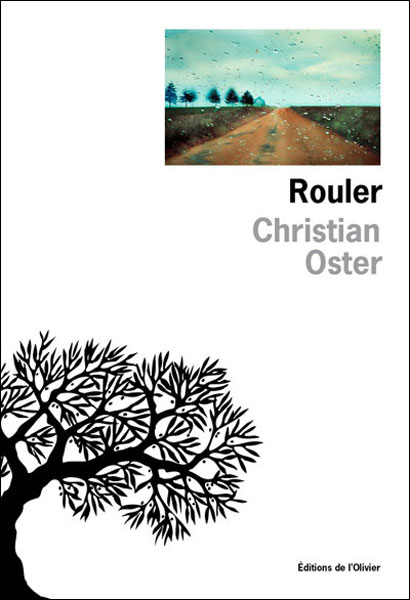 Jean quitte Paris un jour d’été au volant de sa voiture. Un départ sans but, sans parcours déterminé, sauf peut-être celui qui doit le faire suivre des chemins de traverse, des petites routes désertes mais non sans âme. Au fur et à mesure de sa chevauchée, Jean rencontre des individus tous plus singuliers les uns que les autres. Le but du personnage de Christian Oster, prix Médicis en 1999, n’est pas de se couper du monde, il souhaite dit-il, rouler pour marcher un peu, de préférence sur des aires de repos, où l’on croise des gens (…) j’avais besoin de croiser des gens. Il prendra de fait des auto-stoppeurs, une femme qui fuit une petite mort certaine dans un couple qui ne fonctionne plus. De ces moments de confrontation à la vie, Jean apprend à observer, il confronte ainsi, sans forcément le vouloir, son existence à celle des autres. Traversée de villages, traversée de paysages jusqu’à définir un point, Marseille, comme ultime, celui où le parcours s’achèvera. Mais plus le personnage semble se rapprocher de cette destination, plus la distance-temps s’allonge, comme si une nécessité impérieuse se marquait de façon prégnante, la nécessité de repousser l’ultime instant de cette échappatoire. Car que trouvera-t-il une fois arrivé ? Les questionnements ressurgiront-ils ? Envahiront-ils le quotidien de l’homme ? Rouler de Christian Oster pose ces questions, il rend compte de la nécessité pour l’homme de partir. Partir pour se reconstruire, pour être plus et mieux présent pour les autres, pour les proches et finalement pour lui-même. Ce faisant il doit apprendre à bousculer l’ordinaire pour créer l’envie d’avancer malgré tous les obstacles et les peurs qui viennent se greffer sur son existence. Une écriture fluide dans laquelle l’auteur pose des repères pour avancer, pour rouler vers un futur à (re)construire…
Jean quitte Paris un jour d’été au volant de sa voiture. Un départ sans but, sans parcours déterminé, sauf peut-être celui qui doit le faire suivre des chemins de traverse, des petites routes désertes mais non sans âme. Au fur et à mesure de sa chevauchée, Jean rencontre des individus tous plus singuliers les uns que les autres. Le but du personnage de Christian Oster, prix Médicis en 1999, n’est pas de se couper du monde, il souhaite dit-il, rouler pour marcher un peu, de préférence sur des aires de repos, où l’on croise des gens (…) j’avais besoin de croiser des gens. Il prendra de fait des auto-stoppeurs, une femme qui fuit une petite mort certaine dans un couple qui ne fonctionne plus. De ces moments de confrontation à la vie, Jean apprend à observer, il confronte ainsi, sans forcément le vouloir, son existence à celle des autres. Traversée de villages, traversée de paysages jusqu’à définir un point, Marseille, comme ultime, celui où le parcours s’achèvera. Mais plus le personnage semble se rapprocher de cette destination, plus la distance-temps s’allonge, comme si une nécessité impérieuse se marquait de façon prégnante, la nécessité de repousser l’ultime instant de cette échappatoire. Car que trouvera-t-il une fois arrivé ? Les questionnements ressurgiront-ils ? Envahiront-ils le quotidien de l’homme ? Rouler de Christian Oster pose ces questions, il rend compte de la nécessité pour l’homme de partir. Partir pour se reconstruire, pour être plus et mieux présent pour les autres, pour les proches et finalement pour lui-même. Ce faisant il doit apprendre à bousculer l’ordinaire pour créer l’envie d’avancer malgré tous les obstacles et les peurs qui viennent se greffer sur son existence. Une écriture fluide dans laquelle l’auteur pose des repères pour avancer, pour rouler vers un futur à (re)construire…
Christian Oster – Rouler – Editions de l’Olivier – 2011 – 15 euros
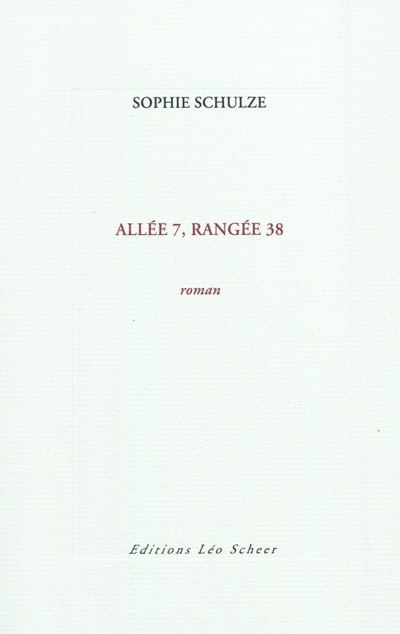
Le destin d’un homme se lit-il dans ces moments éphémères qui précèdent son existence ? Walter naitra d’un amour. Celui de sa mère Franziska pour Karl, un pêcheur attentionné qui lui fait la cour. Mais le père de la jeune fille a d’autres perspectives, celles d’un bon mariage avec Gunther. Franziska cachera sa grossesse à son époux et l’enfant naitra sans amour paternel. Sans père, Walter sera aussi sans patrie, chassé qu’il est de la ferme familiale par son beau-père. Il trouvera refuge en France où il s’engagera dans la légion pour gagner le droit à une existence loin de son Allemagne natale. Hannah Arendt quant à elle suit les enseignements de Heidegger mais elle s’éloigne progressivement de son maitre en se rapprochant du sionisme. Elle quittera elle-aussi l’Allemagne pour fuir le régime nazi. Elle trouvera refuge en France puis aux Etats-Unis où elle rédigera ses textes majeurs. Avec Allée 7, rangée 38, Sophie Schulze nous révèle le destin de ces deux personnages, elle nous livre surtout un premier roman qui pose les questions de l’identité, de la fragilité des êtres, des destins sacrifiés sur l’autel des idéologies. Husserl dont Sophie Schulze reprend les mots énonce ainsi que La crise de l’existence européenne n’a que deux issues : soit la décadence de l’Europe devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel, la chute dans l’hostilité à l’esprit et dans la barbarie ; soit la renaissance de l’Europe à partir de l’esprit de la philosophie, grâce à un héroïsme de la raison qui surmonte définitivement le naturalisme. Le plus grand danger pour l’Europe est la lassitude(…) Walter se reconstruira, il aimera une femme. Dans la petite histoire des êtres se construit la grande histoire, celle qui bouleverse les vies, les égratigne et bouleverse le destin de chacun de nous. En ce sens la question essentielle est de savoir ce que sommes-nous. Une écriture avare de mot mais qui va à l’essentiel, nous oblige à lire à travers les mots pour en saisir toute la portée. Une des bonnes surprises de la rentrée…
Sophie Schulze – Allée 7, rangée 38 – Léo Scheer – 2011 – 15 euros
 A partir d’une anomalie chromatique constatée sur un tableau de Titien, L’homme au gant daté de 1523, Metin Arditi nous tisse le portrait de l’homme qui aurait pu en être le véritable auteur. A travers cette histoire qui nous plonge au cœur de la Turquie et de la Venise du début du XVIème siècle l’auteur de L’imprévisible lie le destin du jeune Elie aux violences de son temps et aux rancœurs tenaces d’une époque dans laquelle la représentation se trouve exclue de la vie quotidienne. Pour le jeune enfant la vie ne peut se concevoir sans un crayon ou une mine de plomb, sans la senteur tenace des encres et des peintures qu’il apprendra à dompter. Mais en Turquie où il a vu le jour quelques années auparavant, le rappel des principes de la religion s’affiche comme un coup de poignard dans un destin tout tracé : Je suis sûr que dans le monde entier il n’y a pas un seul enfant de ton âge qui puisse faire un aussi beau portrait. Mais la Loi nous dit que nous devons représenter ni Dieu ni ses œuvres. Nous ne pouvons que reproduire les textes sacrés, avec humilité, en essayant de rendre toute leur profondeur et leur beauté. Pour assouvir sa passion du dessin, le jeune homme partira, quittera sa terre natale. Ce faisant il devra changer de nom, se construire une histoire, apprendre dans l’ombre des maitres avec modestie pour faire son chemin, graviter dans les sphères des congrégations puissantes de la cité des Doges et s’affirmer enfin au grand jour. A Venise, le Turquetto n’était ni aimé, ni détesté, on le voyait peu. Mais chacun s’accordait à dire que ses tableaux provoquaient des émotions choisies, qui donnaient envie de silence. Que de tous les peintres de la ville, il était le plus grand. Supérieur à Titien et au Véronais. Et qu’il était le seul à avoir réussi la fusion miraculeuse du disegno et du colorito, de la précision florentine et de la douceur vénitienne. Travaillant comme un forçat il révèlera ainsi son talent, celui d’un homme vivant pour son art avec un détachement profond pour toute sorte de reconnaissance. Les toiles qu’il peint se trouvent empreintes d’une âme, elles émeuvent par leur sincérité, elles regorgent d’humanité et d’amour. Pourtant loin de croire aux possibles, sa vie sera marquée à jamais par une œuvre ultime, une œuvre totale qui symbolisera la quintessence de son art. Alors qu’il atteint la marche qui le rapproche de son apogée sa vie basculera, victime de l’incompréhension et de la cruauté des hommes. Avec Le Turquetto, Metin Arditi nous offre un roman qui laisse échapper les parfums des rues de Constantinople et de Venise, qui grave en nous des images d’une époque fourmillante tant sur le plan culturel que politique. Une époque dans laquelle les gloires d’un jour deviennent les incompréhensions du lendemain. Incontournable.
A partir d’une anomalie chromatique constatée sur un tableau de Titien, L’homme au gant daté de 1523, Metin Arditi nous tisse le portrait de l’homme qui aurait pu en être le véritable auteur. A travers cette histoire qui nous plonge au cœur de la Turquie et de la Venise du début du XVIème siècle l’auteur de L’imprévisible lie le destin du jeune Elie aux violences de son temps et aux rancœurs tenaces d’une époque dans laquelle la représentation se trouve exclue de la vie quotidienne. Pour le jeune enfant la vie ne peut se concevoir sans un crayon ou une mine de plomb, sans la senteur tenace des encres et des peintures qu’il apprendra à dompter. Mais en Turquie où il a vu le jour quelques années auparavant, le rappel des principes de la religion s’affiche comme un coup de poignard dans un destin tout tracé : Je suis sûr que dans le monde entier il n’y a pas un seul enfant de ton âge qui puisse faire un aussi beau portrait. Mais la Loi nous dit que nous devons représenter ni Dieu ni ses œuvres. Nous ne pouvons que reproduire les textes sacrés, avec humilité, en essayant de rendre toute leur profondeur et leur beauté. Pour assouvir sa passion du dessin, le jeune homme partira, quittera sa terre natale. Ce faisant il devra changer de nom, se construire une histoire, apprendre dans l’ombre des maitres avec modestie pour faire son chemin, graviter dans les sphères des congrégations puissantes de la cité des Doges et s’affirmer enfin au grand jour. A Venise, le Turquetto n’était ni aimé, ni détesté, on le voyait peu. Mais chacun s’accordait à dire que ses tableaux provoquaient des émotions choisies, qui donnaient envie de silence. Que de tous les peintres de la ville, il était le plus grand. Supérieur à Titien et au Véronais. Et qu’il était le seul à avoir réussi la fusion miraculeuse du disegno et du colorito, de la précision florentine et de la douceur vénitienne. Travaillant comme un forçat il révèlera ainsi son talent, celui d’un homme vivant pour son art avec un détachement profond pour toute sorte de reconnaissance. Les toiles qu’il peint se trouvent empreintes d’une âme, elles émeuvent par leur sincérité, elles regorgent d’humanité et d’amour. Pourtant loin de croire aux possibles, sa vie sera marquée à jamais par une œuvre ultime, une œuvre totale qui symbolisera la quintessence de son art. Alors qu’il atteint la marche qui le rapproche de son apogée sa vie basculera, victime de l’incompréhension et de la cruauté des hommes. Avec Le Turquetto, Metin Arditi nous offre un roman qui laisse échapper les parfums des rues de Constantinople et de Venise, qui grave en nous des images d’une époque fourmillante tant sur le plan culturel que politique. Une époque dans laquelle les gloires d’un jour deviennent les incompréhensions du lendemain. Incontournable.
Metin Arditi – Le Turquetto – Actes Sud – 2011 – 19,50 euros
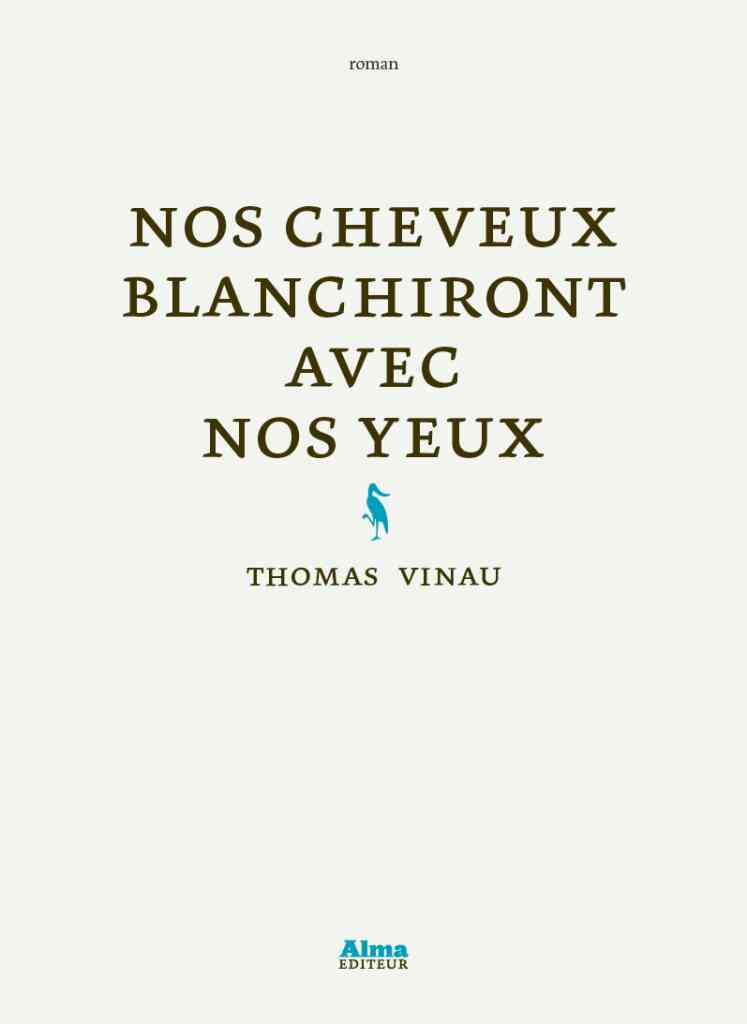 Un homme, Walter, décide de partir. Au loin. De tout laisser en plan, une femme qu’il aime, un enfant à venir et bien d’autres choses. Pourtant ce n’est ni une fuite, ni une rupture mais un besoin qui s’ancre durablement dans son esprit. Le jeune homme va devenir père. Ce nouveau statut le pousse à une réflexion, une introspection qui se doit d’être menée à bien pour lui permettre de revenir et d’accomplir son rôle et ses obligations nouvelles. La femme accepte le départ. Elle sait au fond d’elle-même que ce n’en est pas un. Celui qu’elle aime va finir d’achever définitivement sa mue entamée il y a une petite quinzaine d’année. Et son retour, même si aucune date n’est donnée, est déjà programmé. Thomas Vinau est poète. Nos cheveux blanchiront avec nos yeux agrémente donc sa bibliographie d’un premier roman. Roman bref, qui va à l’essentiel, aux sentiments, qui ne s’embarrasse pas de digressions ou d’envolées lyriques ostentatoires destinées à nous impressionner ou à nous rallier à lui. Il observe et narre cette longue traversée de l’homme à travers l’Europe. Il y est question de rencontres, de chambre d’hôtels, d’auteurs essentiels, Camus, Kafka, Walter Benjamin, François de Cornière, Shakespeare, et bien d’autres encore et de musique. Une musique qui accompagne l’homme tout au long de cette traversée, qui rythme ses moments de blues et son retour en père attentionné. Car le retour s’amorce. Il est en gestation lente dans les lettres envoyées à celle qu’il aime et qui le rattachent à elle :
Un homme, Walter, décide de partir. Au loin. De tout laisser en plan, une femme qu’il aime, un enfant à venir et bien d’autres choses. Pourtant ce n’est ni une fuite, ni une rupture mais un besoin qui s’ancre durablement dans son esprit. Le jeune homme va devenir père. Ce nouveau statut le pousse à une réflexion, une introspection qui se doit d’être menée à bien pour lui permettre de revenir et d’accomplir son rôle et ses obligations nouvelles. La femme accepte le départ. Elle sait au fond d’elle-même que ce n’en est pas un. Celui qu’elle aime va finir d’achever définitivement sa mue entamée il y a une petite quinzaine d’année. Et son retour, même si aucune date n’est donnée, est déjà programmé. Thomas Vinau est poète. Nos cheveux blanchiront avec nos yeux agrémente donc sa bibliographie d’un premier roman. Roman bref, qui va à l’essentiel, aux sentiments, qui ne s’embarrasse pas de digressions ou d’envolées lyriques ostentatoires destinées à nous impressionner ou à nous rallier à lui. Il observe et narre cette longue traversée de l’homme à travers l’Europe. Il y est question de rencontres, de chambre d’hôtels, d’auteurs essentiels, Camus, Kafka, Walter Benjamin, François de Cornière, Shakespeare, et bien d’autres encore et de musique. Une musique qui accompagne l’homme tout au long de cette traversée, qui rythme ses moments de blues et son retour en père attentionné. Car le retour s’amorce. Il est en gestation lente dans les lettres envoyées à celle qu’il aime et qui le rattachent à elle :
Ma Sally,
Je me retrouve à des milliers de kilomètres de chez nous.
Les murs de ma chambre sont recouverts de moquette
verte et par la fenêtre je peux voir deux ou trois orangers
qui bordent la route. Je ne suis pas chez moi ici.
Je ne suis nulle part chez moi. Il y a ce gros bloc de nuit
et de temps qui nous sépare. Mais je n’ai pas la sensation
de subir cette distance. Au contraire, elle est toute chaude.
Elle me rapproche de toi.
W.
P.S. : ici les amoureux s’appellent Mi vida.
Thomas Vinau ne souhaitait pas laisser son héro au loin, il voulait lui donner vie après le retour. Son roman se trouve donc décomposé en deux parties distinctes : Le dehors du dedans et le dedans du dehors. Là où le « il » accompagnait le voyage, la cellule familiale nouvelle se rédige à la première personne du singulier. Walter devient le père, il nous conte les moments d’intimité vécus avec ceux qu’il aime. En toute modestie et sans faire le filtre des sentiments qui l’anime. Nos cheveux blanchiront avec nos yeux possède une force d’attraction difficile à définir. Peut-être nous identifions-nous à ce parcours, le comprenons-nous tout du moins. Sans révolutionner le genre, Thomas Vinau nous offre un roman poétique teinté de moments de vie qu’il décortique et analyse au microscope des sentiments. Il restera à n’en pas douter des traces de cette lecture en chacun de nous…
Thomas Vinau – Nos cheveux blanchiront avec nos yeux – Alma éditeur – 2011 – 12,80 euros
Interview de Thomas Vinau
Comment s’est imposé à vous ce roman ?
Il ne s’est pas imposé à moi mais il est devenu nécessaire, avec le temps, avec les échéances de ma propre vie, la fin d’une certaine jeunesse, le début de la paternité, etc.
Vous avez souhaité diviser en deux parties « Le dehors du dedans » et « Le dedans du dehors » votre texte. Pourquoi ce choix ?
Cela s’est articulé ainsi dans la construction du texte, qui s’est faîte sur plusieurs années. Est apparue la nécessité d’un diptyque dont les deux parties se compléteraient, se répondraient. Dont les bosses de l’une viendraient remplir les trous de l’autre.
La première partie est écrite à la troisième personne du singulier tandis que la seconde l’est à la première du singulier. Pour vous le « Je » de la seconde partie est-il un moyen d’entrer de manière plus sensible dans la vie du personnage ?
Oui, il n’y a plus la distance du personnage décrit. C’est un point de vue plus intime, plus direct, plus sensible, dans l’esprit de cette complémentarité des deux parties.
Vous reprenez en exergue cette phrase de Blaise Cendrars qui ouvre la première partie « Quand on aime il faut partir ». Votre première partie tourne autour de cette phrase. Votre personnage décide de partir au début de la grossesse de son amie. Ce n’est pas une fuite, ni un désamour mais peut-on dire qu’il s’agit d’un besoin, d’une nécessité ?
Oui, une urgence. Le besoin de prendre un grand élan, de s’achever aussi. Et de mieux revenir.
Plus votre personnage se trouve loin de celle qu’il aime plus l’amour semble se renforcer, par le biais des lettres écrites à Sally mais aussi par la découverte de celui qu’il est. Votre personnage se renforce t-il de chaque expérience ?
Il se rempli. Essaie tout au moins. Il ne doutait pas de l’amour qu’il éprouvait pour Salie mais de sa capacité à assumer ce qu’ils sont en train de construire. Mais la quête est un peu vaine, et c’est plutôt dans la seconde partie, lorsqu’il est rentré et qu’il affronte sa vie qu’il commence vraiment à se remplir. Trop même. Ça le submerge.
La seconde partie nous donne à voir le père, attentionné, protecteur, observateur. Nous passons de l’infiniment grand (L’Europe du Nord au Sud de la première partie) à l’infiniment petit (le microcosme familial). Le premier était-il essentiel à votre personnage pour appréhender le second ?
OUI absolument, encore une fois, cette histoire de tas et de trous…
Vous avez souhaité construire votre récit par succession de petits moments de vie posés les uns à la suite des autres, comme un journal intime. Pourquoi avoir opté pour cette forme ?
Cette forme par fragments, par proses poétiques, amène quelque chose d’autre à la narration. Une vision à l’os, sans détour, sans fioriture. Une dimension plus cinématographique aussi. Des scènes, des images.
La poésie domine ce roman de bout en bout. Finalement Nos cheveux blanchiront avec nos yeux doit-il se lire comme un roman poétique ou comme une poésie romancée ?
Je voulais que les deux, justement, s’épaulent et marchent ensemble.
Que retenez-vous de l’écriture de ce texte ?
L’envie d’en écrire d’autres. Cette forme « transversale » me plaît, me permet de creuser et de raconter sans me perdre.
L’espoir qu’il parle aux autres, aux lecteurs, à hauteur d’homme.







